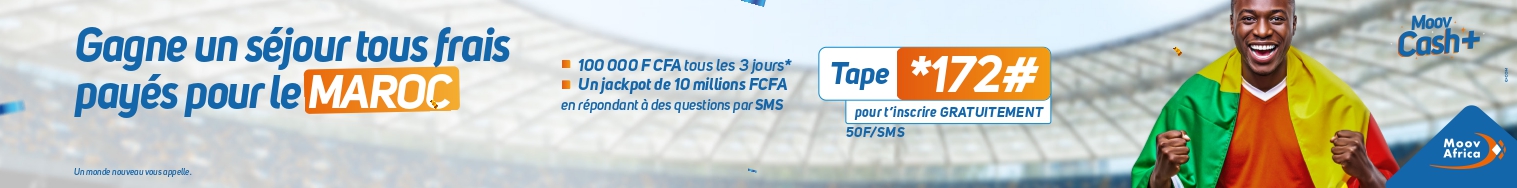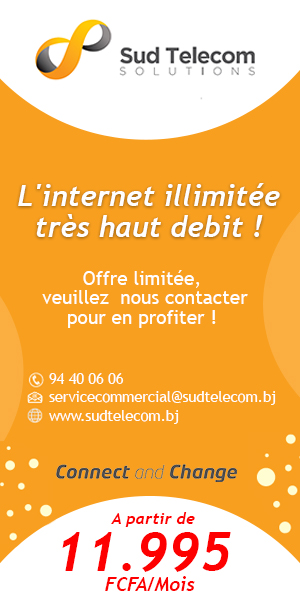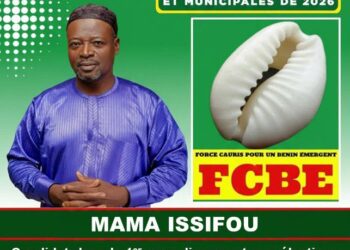À Malanville, une commune frontalière avec le Niger, au nord du Bénin, l’agriculture et l’élevage subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. Les sécheresses répétées raréfient les pâturages, amplifiant les tensions entre agriculteurs et éleveurs. Mais une pratique innovante est en train d’émerger, celle de la culture du niébé, non pas pour ses graines, mais pour ses fanes, devenues une ressource fourragère précieuse pour les animaux. Un reportage de Loukoumane Worou Tchehou à lire sur Mongabay
Lire aussi : Bénin, Guinée et Togo : le lourd tribut de l’extraction abusive de sable et de granite sur le climat
Ce jeudi 25 septembre 2025, le jour se lève à peine que déjà le soleil illumine la plaine de sa lumière orangée. Nous sommes à Monkolé, un hameau de Goungoun, dans l’arrondissement de Guéné, près de la frontière nigérienne. Souléymane Amadou sort de sa maison en banco, machette à la main. Le chant d’un coq se mêle au bêlement lointain des vaches. Aujourd’hui encore, il doit couper du niébé, mais pas pour les graines. Amadou tranche les plants d’un geste sûr. « Par le passé, je cultivais le niébé pour ses graines. Mais, depuis un moment, avec l’incertitude autour de la saison dominée par les poches de sécheresse, les récoltes ne comblent plus nos attentes. J’ai décidé alors de vendre la végétation comme fourrage aux éleveurs », explique-t-il, en formant des bottes qu’il attache avec des cordelettes végétales.
Les oiseaux tournoient dans le ciel. Dans le silence du matin, seul le bruit régulier de la machette brise l’air frais. À environ 600 mètres, Karim Inoussa, un autre producteur, empile déjà plusieurs dizaines de bottes sous un grand arbre de karité. « Ceux qui cherchent à nourrir leurs bétails viennent chercher directement ici. Certains achètent en laissant ça sécher et entreposer dans un endroit pour sa conservation en attendant la saison sèche. C’est devenu une vraie source de revenus pour moi », dit-il, essoufflé mais fier.
Selon les témoignages des producteurs, la botte d’environ 1 kilogramme se vend jusqu’à 800 francs CFA (1,80 USD) voire 1000 francs CFA (2,30 USD), selon les périodes.
Le déclic d’une production qui devient populaire
La production du niébé pour ses fanes a pris une place importante dans l’activité champêtre des agriculteurs dans les villages environnants de Malanville, au nord du Bénin.
À Boïffo, une localité à la lisière du Parc national du W, une aire protégée partagée entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, David Labo, un responsable d’association villageoise de producteurs, confirme cette tendance. « C’est une manière pour les agriculteurs de gagner de l’argent, mais également de sauver les bétails dans notre région, où il est difficile de trouver de quoi nourrir les animaux, surtout pendant la longue période de sécheresse, qui dure plusieurs mois [soit de novembre à mai, Ndlr] », explique Labo. Pour lui, les acteurs agropastoraux ont trouvé un moyen de contourner leurs difficultés.

Cette baisse de pâturage, à Malanville est imputée au changement climatique. Les anciens se souviennent de pluies régulières, de mares chargées d’eau toute l’année, et de vastes étendues, où les troupeaux broutaient librement. « Lorsque nous étions petits, tous ces espaces étaient des lieux où les bœufs et moutons venaient brouter », dit Mamoudou Harfari, la soixantaine environ, habitant à Kantoro, un hameau de Guéné, situé à une quinzaine de kilomètres de l’arrondissement central, sur la route non bitumée de Karimama.
Aujourd’hui, ces paysages appartiennent au passé. Une situation due au dérèglement du climat, selon le climatologue, Dr Houdou Maazou. « Le changement climatique affecte les pâturages et l’élevage dans la région de Malanville, ainsi que dans le Sahel en intensifiant les sécheresses et en rendant les pluies plus irrégulières, ce qui réduit la disponibilité des ressources en eau, et des pâturages essentiels à la survie du bétail ».
Dans les champs, le fourrage de niébé est cultivé sur des hectares dans des villages sans grandes contraintes, car il nécessite moins d’entretien que la culture des graines, qui demande des soins réguliers tels que le sarclage, le traitement contre les maladies et parasites. Il sera attaché en bottes, puis transporté sur des charrettes ou des motos en direction des agglomérations pour être stocké. « Je n’ai pas besoin d’utiliser des intrants agricoles pour cultiver le niébé fourrager. Je m’en sors avec plus de 200 000 francs CFA (356 USD), après la vente de la plante », confie Souléymane Amadou.

Le niébé, un espoir pour les éleveurs
À Wollo, un quartier des éleveurs à Malanville, plusieurs personnes optent pour la sédentarisation de l’élevage. Dans un enclos, les vaches se pressent autour des bottes de niébé asséchées. « Regardez comme elles mangent ! », admire l’éleveur, Aminou Moussa, l’air soulagé. « Sans ce fourrage, nos troupeaux n’auraient rien. Le niébé nous aide à traverser la saison sèche ». Il sera renchéri par Soumana Guidado, facilitateur en production des cultures fourragères pour le compte du Programme régionale d’intégration des marchés agricoles (PRIMA) à Malanville, une initiative soutenue par le Fonds international de développement agricole (FIDA), visant à stimuler le commerce agricole régional, notamment au Bénin et au Togo, pour améliorer la sécurité alimentaire. Une botte sèche de niébé en main, il avance vers les chèvres et les moutons qui s’approchent de lui en bêlant d’impatience. « Dans le but de lutter contre la sécheresse et d’alimenter les animaux. Il n’y a plus de fourrage frais en contre-saison. Il y a des animaux qui meurent sans maladie », souligne cet agro-éleveur, qui pointe du doigt la raréfaction des pâturages.
Il rappelle quelques sites devenus de vieux souvenirs à Malanville. Ils sont rendus inaccessibles aux troupeaux par des cultures champêtres. « Nous n’avons plus assez d’espace pour paître les animaux. Et, grâce au niébé, nos animaux mangent mieux et restent en bonne santé. Il est riche en protéines. En deux semaines d’alimentation au niébé, vous constatez le changement chez l’animal », dit Guidado.
Au marché, les bêtes attachées sont nourries au niébé la plupart du temps. Bouraïma Baba, un vendeur des ovins au marché de bétails de Tourakou situé au nord-ouest de la ville de Malanville, justifie cette option par les bienfaits de cette plante pour les bêtes. « Lorsque vos animaux sont nourris aux feuilles de niébé, vous remarquerez qu’ils présentent un bon état », confie le vendeur de moutons à Tourakou.

Pour Dr Afizou Ganda, de l’Agence territoriale de développement agricole-Vallée du Niger, cette réorientation est un signe d’intelligence locale. « Le niébé est beaucoup plus connu pour son rôle dans l’alimentation animale. Les agro-éleveurs utilisent les fanes de niébé pour assurer l’alimentation pendant les périodes difficiles de leurs animaux, qu’il s’agisse de petits ruminants comme les caprins et ovins, ou des bovins », dit-il, avant d’expliquer comment la culture de cette légumineuse répond aux difficultés d’accès aux fourrages. « Dans notre zone, après la saison des pluies, trouver du fourrage devient compliqué, car toutes les herbes deviennent sèches. Le niébé devient alors une source alternative essentielle de protéines pour les ruminants. La plupart du temps, les animaux ne broutent que des graminées comme les pailles de maïs ou de sorgho, mais les sources protéiques sont rares. Aujourd’hui, le niébé fourrager joue ce rôle ».
Dr Maazou insiste sur la portée régionale de l’expérience. « Ce qui se passe à Malanville peut inspirer d’autres régions du Sahel. L’adaptation ne passe pas toujours par des projets coûteux. Parfois, il suffit d’un changement d’usage pour transformer une pratique agricole en outil de résilience».
Par ailleurs, « le niébé a plusieurs avantages. Il pousse bien dans des conditions d’insuffisance pluviométrique, restitue de l’azote au sol, améliore la fertilité et, en plus, sert de fourrage de qualité. Les agriculteurs et éleveurs de Malanville nous montrent qu’une culture traditionnelle peut devenir une solution moderne au climat », dit l’agronome.

Les solutions les plus durables se trouvent sous nos pieds, dans nos champs…
Au-delà d’une alimentation animale, Dr Ganda souligne que cette légumineuse est un excellent fertilisant du sol. C’est d’ailleurs pourquoi il est conseillé de cultiver les légumineuses sur des sols fatigués, afin de les restaurer, selon lui.
Au plan environnemental, il indique que le niébé protège le sol qui est entièrement couvert contre l’érosion éolienne, contre l’érosion hydrique liée à la pluie et participe à la régénération des sols dégradés ; permettant à des zones sèches, sahéliennes notamment, de pouvoir faire face aux difficultés à alimenter les animaux, surtout que de plus en plus la transhumance transfrontalière est restreinte. « Ils peuvent disposer de pâturage de sources protéiniques pour pouvoir alimenter leurs bétails. C’est une excellente solution alternative pour l’alimentation animale face aux changements climatiques et autres », dit-il.
Comme facteurs de réussite, ce responsable à l’ATDA recommande, en plus de la disponibilité de l’espace, une bonne variété du niébé et l’entretien des plants.
À l’heure où les sécheresses s’intensifient et où les tensions montent dans tout le Sahel, l’expérience de Malanville illustre une réalité, celle de l’innovation qui naît parfois d’une pratique ordinaire, mais réinventée. Une plante banale, cultivée autrement, peut changer le destin de toute une communauté.
Dans un monde secoué par les sécheresses et les crises alimentaires, le message de Malanville est clair. Parfois, les solutions les plus durables se trouvent sous nos pieds, dans nos champs, et dans une simple plante cultivée avec soin et détermination.
Le niébé fourrager n’est pas qu’un aliment pour le bétail. C’est un symbole de résilience, un ferment de vie dans un paysage asséché, et une preuve que l’ingéniosité locale peut répondre aux défis du climat. À Malanville, les hommes, les femmes et leurs troupeaux vivent cette transformation au quotidien, et pour eux, chaque botte de niébé est un pas de plus vers un avenir plus vert et plus sûr.