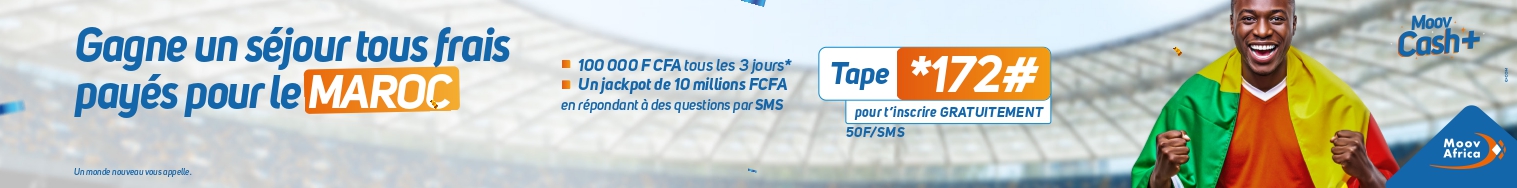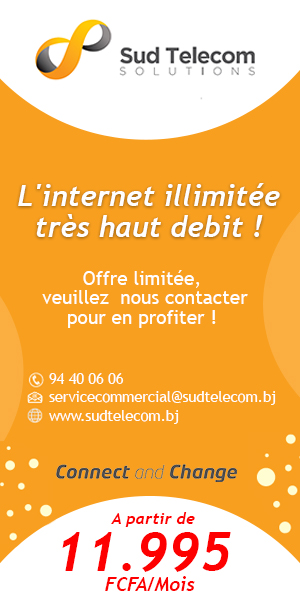La nationalisation de certains métiers précaires au Gabon. C’est le sujet qui secoue la toile béninoise et celle gabonaise. En interdisant aux étrangers l’accès à une série de petits métiers, Libreville dit vouloir protéger ses citoyens et assainir l’économie informelle. Mais la mesure, entrée en vigueur le 12 août, a provoqué des tensions, notamment avec la communauté béninoise installée au Gabon.
Une vidéo virale
Tout est parti d’une séquence publiée sur les réseaux sociaux par Tata Bertille, une influenceuse gabonaise. Dans cette vidéo, elle interpelle directement les vendeuses béninoises installées au marché de Lambaréné, ville du Centre-Ouest du Gabon, située à 237 km de Libreville, dans la province du Moyen-Ogooué. Des vendeuses qu’elle filmait sans leur autorisation. « Vous allez vendre au Bénin. Vous n’allez pas vendre ici », lance-t-elle, provoquant une vague de réactions et de tensions sur les réseaux sociaux et entre les deux pays. Depuis, les Béninois vivant au Gabon disent subir menaces, intimidations et harcèlement. La réaction du maire du deuxième arrondissement de Lambaréné n’a pas tardé. Selon l’autorité locale, les femmes étrangères notamment les Béninoises et des Camerounaises ont obtenu des places dans ces marchés parce qu’elles fournissent de la marchandise nécessaire à l’alimentation de la population gabonaise. Le maire a ensuite explique que la réalité est que les femmes gabonaises préfèrent se terrer dans des forêts au lieu d’occuper des places du marché. “Il n’y a pas de place pour la xénophobie dans un marché (au Gabon), a-t-il conclu.
Les réformes annoncées par Libreville
Mardi 12 août, à l’issue d’un Conseil des ministres, le gouvernement a, dans la foulée, interdit aux étrangers au Gabon d’exercer plusieurs métiers précaires comme :
le commerce de proximité et vente ambulante,
- la petite restauration et vente de produits manufacturés locaux,
- la couture et réparation de chaussures,
- la coiffure et soins esthétiques de rue,
- la réparation de téléphones, ordinateurs et petits appareils,
- les petits travaux de bâtiment (peinture, maçonnerie légère),
- l’orpaillage artisanal non autorisé,
- l’intermédiation informelle dans l’achat de récoltes,
- l’exploitation de petits ateliers ou de machines de jeux sans enregistrement.
Selon Libreville, ces restrictions répondent à une double ambition : réduire le chômage national et reprendre la main sur l’économie informelle, jugée incontrôlée et parfois utilisée à des fins illégales. « Ces réformes visent à offrir aux Gabonais, et en priorité à la jeunesse, les moyens de leur autonomie économique », a expliqué le communiqué officiel, lu par la Porte-parole du gouvernement Laurence Ndong.
Cotonou appelle au calme
Face à la montée des tensions, le Bénin a réagi le 14 août par un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Tout en reconnaissant au Gabon le droit de légiférer, Cotonou a assuré qu’il protégerait ses ressortissants. Le gouvernement béninois appelle ses citoyens à « la sérénité et à la retenue » et annonce une mission de recensement en vue d’organiser le retour volontaire de ceux qui le souhaitent. Le Bénin rappelle par ailleurs son attachement à une Afrique unie et solidaire, tout en insistant sur la nécessité de respecter les législations nationales.
Le précédent historique de 1977
Les tensions actuelles rappellent un épisode sombre des relations entre Cotonou et Libreville. Le 16 janvier 1977, le Bénin du feu général Mathieu Kérékou a subi une attaque mercenaire conduite par le Français Bob Denard. Selon les services de renseignements béninois, l’opération aurait été préparée au Gabon avec la complicité du feu président Omar Bongo. En représailles, Kérékou boycotte le sommet de l’Organisation de l’Union Africaine (actuelle Union Africaine) organisé la même année à Libreville, avant de dénoncer publiquement en 1978, à Khartoum au Soudan, le rôle du Gabon dans cette tentative de déstabilisation. Ses propos déclenchent alors une vague de violences contre les commerçants béninois au Gabon : pillages, agressions et expulsions massives d’environ 10 000 ressortissants.
Faradj ALI YAROU