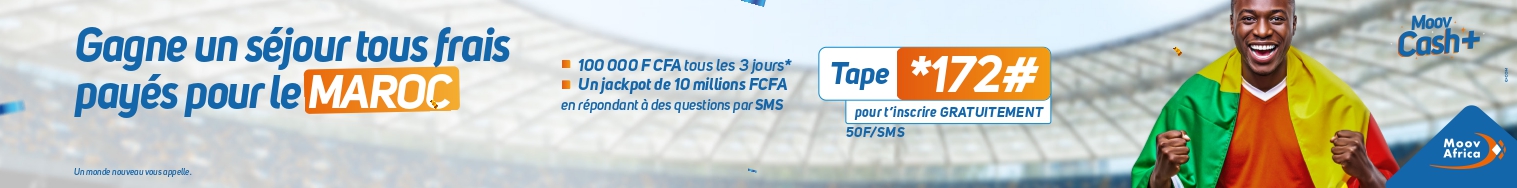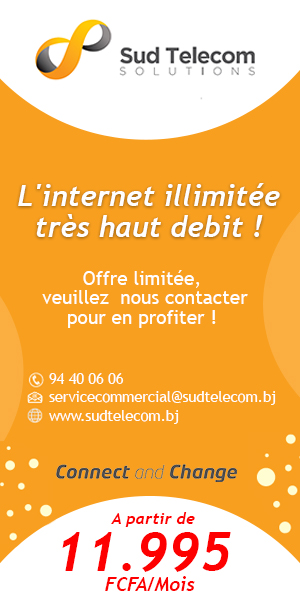Réunis à Copenhague ce jeudi 2 octobre 2025, les dirigeants des 47 pays de la Communauté politique européenne ont tenté d’afficher un front uni autour de la sécurité du continent. Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et les tensions croissantes avec Moscou, les débats ont surtout révélé la difficulté d’harmoniser les positions au-delà des frontières de l’Union européenne. Si l’idée d’un soutien accru à Kiev et l’utilisation des avoirs russes gelés ont trouvé un écho favorable auprès de plusieurs capitales, les réticences persistantes, notamment de la Hongrie, rappellent la fragilité du consensus européen.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité d’honneur du sommet, a salué la volonté de plusieurs États de transformer les avoirs russes gelés en un levier financier pour l’effort de guerre. Le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté sur la nécessité de faire preuve de fermeté afin que « Poutine ne sous-estime pas la détermination de l’Europe ». Mais en contrepoint, Viktor Orban a de nouveau exprimé son opposition à une adhésion de l’Ukraine à l’UE et à l’Otan, proposant plutôt un « accord stratégique » distinct, une position qui souligne les fractures persistantes au sein du continent.
Au-delà de l’Ukraine, le projet d’un mur anti-drones, susceptible de protéger aussi bien les pays de l’UE que ceux hors de l’Union, a suscité un intérêt commun, apparaissant comme l’un des rares points de convergence. Pendant ce temps, le Kremlin a dénoncé « la militarisation croissante de l’Europe » et promis une riposte. Ainsi, le sommet de Copenhague met en lumière un paradoxe : l’Europe se veut solidaire face aux menaces, mais ses divisions internes sur la stratégie à adopter demeurent un obstacle majeur à la construction d’une véritable sécurité collective.