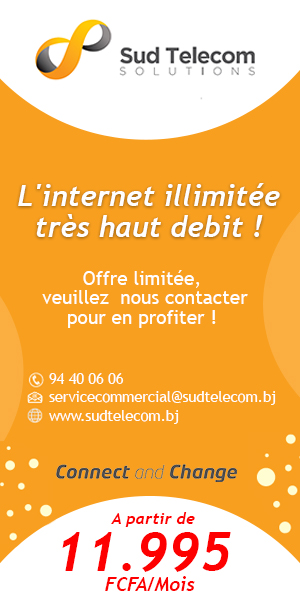Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté ce lundi une résolution historique portant sur le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump, visant à stabiliser durablement la situation à Gaza. Treize des quinze membres du Conseil ont voté en faveur du texte, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenues. Présentée par l’ambassadeur américain Mike Waltz, la résolution a été qualifiée de « constructive » et constitue une étape majeure dans la recherche d’une solution dans un territoire dévasté par deux années de conflit. Le vote consacre ainsi le rôle de l’ONU comme arbitre des initiatives internationales de paix et de stabilité au Moyen-Orient, en dépit des divergences persistantes entre grandes puissances.
Le texte adopté « endosse » officiellement le plan annoncé par Donald Trump, qui a permis, dès le 10 octobre, la mise en place d’un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas. Il autorise l’installation d’une « force de stabilisation internationale » (ISF) chargée entre autres de contrôler les frontières avec l’appui d’Israël et de l’Égypte, de démilitariser Gaza, de désarmer les groupes armés et de protéger les populations civiles. Ce mandat s’étend jusqu’en 2027 via la création d’un « Comité de la paix », organe de transition piloté par l’Autorité palestinienne, dont la présidence a été attribuée à Donald Trump dans le cadre du plan en 20 points annexé à la résolution. L’ONU s’impose ici comme garante de l’architecture institutionnelle visant à restaurer la paix tout en prévoyant une réforme profonde de la gouvernance palestinienne.
Cependant, de nombreuses zones d’ombre persistent quant à l’application concrète de ce plan, notamment sur la reconstruction de Gaza ou la neutralisation du Hamas. Si l’administration américaine se félicite d’un accord qui « apportera davantage de paix dans le monde », les observateurs restent prudents. Pour certains experts, comme Karim-Emile Bitar de Sciences-Po Paris, la résolution représente une fusion hâtive de différentes propositions diplomatiques – américaines, franco-saoudiennes, turques, qataries et égyptiennes – formant un cadre peu réaliste sur le terrain. L’ONU, bien qu’elle joue ici un rôle décisif dans la coordination des initiatives de paix, est ainsi confrontée au défi de transformer cette résolution ambitieuse en une réalité tangible, dans un contexte où les tensions restent vives et les équilibres régionaux fragiles.