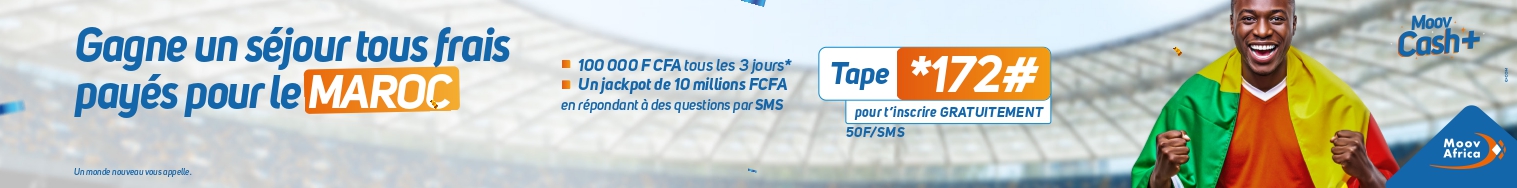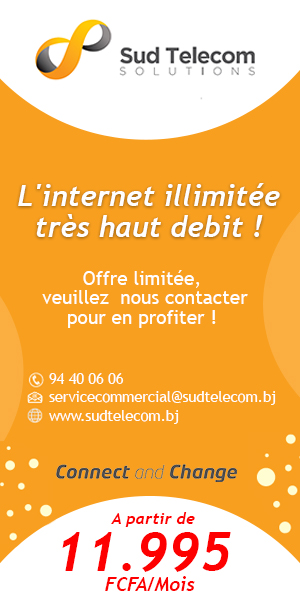L’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire, à 83 ans, soulève une vague d’indignation et de profonde inquiétude au-delà des frontières ivoiriennes. En choisissant de revenir sur sa promesse solennelle de 2020 de céder le pouvoir à une nouvelle génération, le chef de l’État envoie un signal troublant : celui d’un homme d’État qui, au nom de la stabilité, fait primer la longévité personnelle sur le respect des engagements démocratiques. Un dangereux précédent, surtout dans une région où les transitions pacifiques et respectueuses de la Constitution restent fragiles.
Derrière les justifications évoquant « l’intérêt supérieur de la nation » et « l’appel du peuple », se cache une vieille stratégie désormais bien connue sur le continent : celle de l’homme providentiel, seul à même de garantir la paix et la sécurité, même après plusieurs décennies au pouvoir. Or, si la lutte contre le terrorisme et les défis économiques sont réels, ils ne sauraient justifier un recul démocratique. À force de repousser sans cesse le départ des dirigeants, l’Afrique risque de sombrer dans une fatigue institutionnelle où les alternances deviennent l’exception et non la règle.
Cette décision de Ouattara pourrait faire des émules. Car lorsque des figures aussi emblématiques se permettent de revenir sur leur parole sans réelle contestation interne, cela donne des idées à d’autres chefs d’État. L’Afrique a pourtant besoin d’exemples de leaders capables de partir par la grande porte, en respectant leur parole, pour faire éclore une nouvelle génération d’acteurs politiques. Le quatrième mandat de Ouattara, s’il se concrétise, pourrait ainsi devenir le symbole d’une régression démocratique à l’échelle ouest-africaine. Une régression qui ne profite ni aux peuples, ni à l’image du continent.