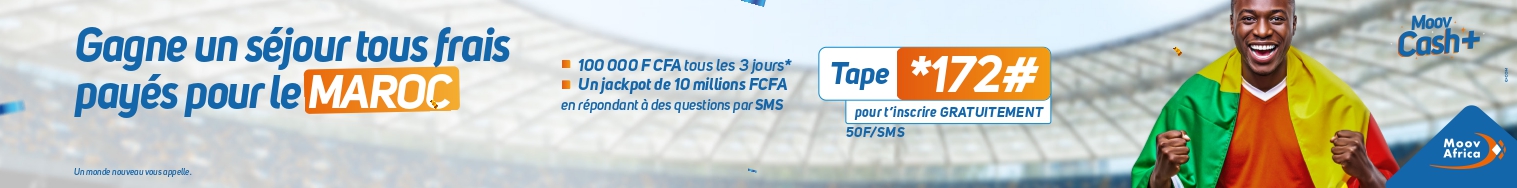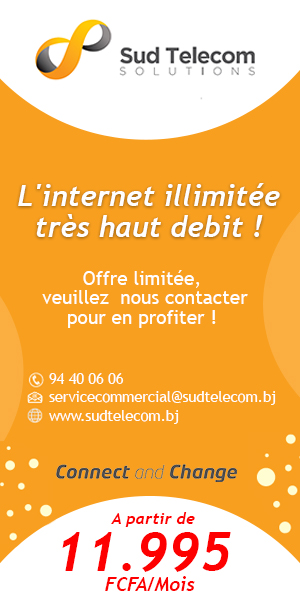Après plus de deux années de guerre meurtrière, la Russie et l’Ukraine amorcent un frémissement diplomatique. Les racines du conflit, qui remonte à l’invasion russe de 2022, restent profondément ancrées dans des tensions géopolitiques complexes, mêlant souveraineté, sécurité régionale et rivalités historiques. Le bilan humain et matériel est lourd, et malgré de nombreuses médiations internationales, la paix reste insaisissable. Le climat demeure tendu, alimenté par des frappes régulières, une militarisation accrue et une méfiance mutuelle.
Dans ce contexte, les récentes discussions tenues à Istanbul marquent un tournant, bien que fragile. Pour la première fois depuis le début du conflit, des représentants des deux camps se sont assis à la même table, favorisant un dialogue indirectement soutenu par des puissances neutres. Cette rencontre a débouché sur un échange de prisonniers, signe d’un léger dégel humanitaire. Toutefois, les divergences fondamentales demeurent, notamment sur les conditions d’un cessez-le-feu durable : l’Ukraine exige un retrait total des troupes russes, pendant que Moscou pose des conditions géostratégiques jugées inacceptables par Kiev.
Si ces premiers contacts ne présagent pas encore d’un sommet entre les chefs d’État, ils révèlent un début de repositionnement des deux parties. Sous pression internationale et face à l’épuisement progressif des ressources humaines et économiques, Moscou comme Kiev pourraient être amenés à explorer des concessions minimales. La voie de la paix reste étroite, mais elle n’est plus entièrement fermée. Le défi réside désormais dans la capacité des médiateurs à transformer ces gestes limités en une dynamique politique de désescalade.