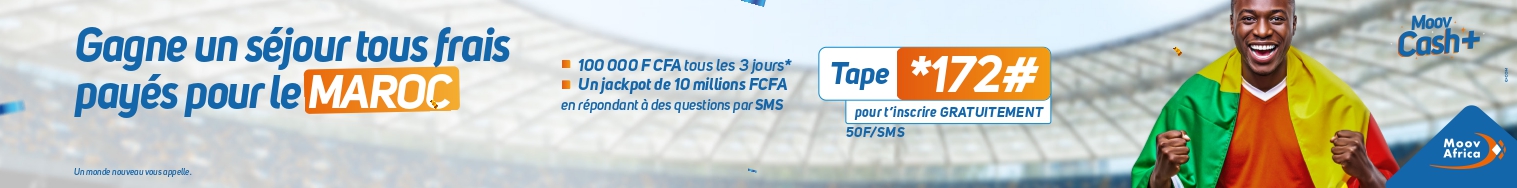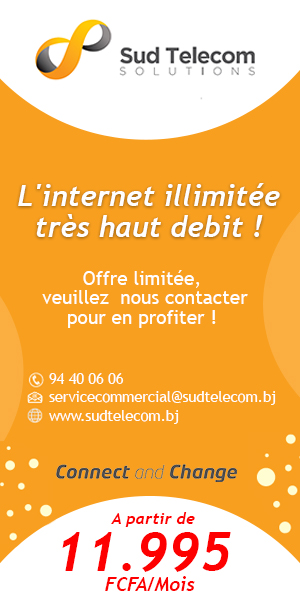À moins d’un an de la présidentielle de 2026, le climat politique béninois se distingue par une étonnante léthargie. Habituellement, cette période est marquée par une montée progressive de l’agitation politique : déclarations d’intention, alliances stratégiques, positionnements publics… Mais cette fois, un silence pesant domine l’espace public. Ni la majorité présidentielle ni l’opposition ne dévoilent leurs cartes. Cette discrétion généralisée surprend plus d’un, tant elle contraste avec la tradition politique nationale où, bien avant l’année électorale, les figures majeures se font déjà connaître et les débats s’intensifient.
Ce mutisme stratégique alimente toutes sortes de spéculations. Du côté de la mouvance, on semble avoir opté pour une communication minimaliste, presque verrouillée, sur la question de la succession. Les potentiels candidats sont tenus dans l’ombre, et aucune dynamique visible ne permet de deviner la direction prise. Une situation qui semble forcer l’opposition à adopter une posture attentiste. Contrairement à l’idée que certains se font d’une opposition timorée ou désorganisée, il s’agirait plutôt d’un calcul : caler son tempo sur celui de la mouvance pour ne pas s’exposer prématurément et adapter ses stratégies en fonction du jeu que mène le pouvoir en place.
Ce choix tactique révèle une transformation profonde de la manière dont les acteurs politiques envisagent la bataille électorale au Bénin. L’opposition, qui dans d’autres contextes aurait déjà affiché un visage, semble jouer une partie d’échecs où chaque coup est conditionné par celui de l’adversaire. Cette forme de prudence inédite montre que le paysage politique est devenu plus imprévisible, plus stratégique, mais aussi moins lisible pour les citoyens. Dans un contexte où les enjeux de transparence, de représentativité et de compétition démocratique restent cruciaux, cette absence de clarté risque d’accentuer la distance entre les acteurs politiques et la population, déjà en proie à une certaine désillusion.