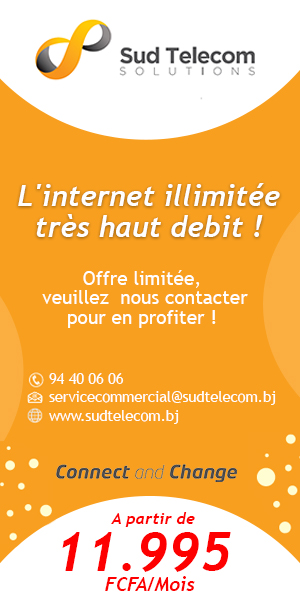En février 1990, le Bénin entrait dans l’histoire en organisant la Conférence nationale des forces vives, un tournant décisif qui allait consacrer le renouveau démocratique du pays. Cet événement fondateur a permis l’adoption du multipartisme intégral, la séparation des pouvoirs, l’instauration de la liberté d’expression et la mise en place d’institutions démocratiques solides.
Trente-cinq ans plus tard, que reste-t-il de ces acquis démocratiques ? Cette interrogation, loin d’être anodine, s’impose face aux évolutions politiques et institutionnelles du pays. Si le Bénin a longtemps été cité en exemple pour sa stabilité et son modèle démocratique, des signaux préoccupants suscitent aujourd’hui des doutes quant à la pérennité des principes défendus en 1990.
Un bilan contrasté des libertés démocratiques
Le droit à la liberté d’opinion et d’expression, jadis brandi comme un acquis inaliénable, est désormais mis à rude épreuve. Plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer un recul de ces libertés à travers des restrictions de plus en plus marquées, notamment à l’égard des médias et des acteurs politiques de l’opposition. Des journalistes et opposants politiques ont fait face à des condamnations judiciaires qui interrogent sur l’état réel de la liberté d’expression.
Le pluralisme politique, autre pilier fondamental issu de la Conférence nationale, semble également fragilisé. Si plusieurs partis existent sur le papier, le cadre légal imposé ces dernières années a rendu plus difficile leur participation effective aux élections. La concentration du pouvoir autour d’une majorité dominante alimente les craintes d’un retour à une gouvernance moins inclusive.
Une gouvernance en mutation : entre réformes et crispations
Les réformes institutionnelles engagées ces dernières années ont profondément transformé le paysage politique. La réforme du système partisan visait à structurer davantage l’échiquier politique, mais ses effets ont suscité des critiques sur l’accessibilité à la compétition électorale. De même, l’indépendance de la justice, garantie essentielle dans un État de droit, est souvent questionnée face à certaines décisions judiciaires perçues comme influencées par le pouvoir en place.
Malgré ces évolutions, le Bénin demeure une nation engagée sur la voie de la modernisation, avec des efforts visibles dans le domaine économique et infrastructurel. Toutefois, la question démocratique ne saurait être reléguée au second plan, car elle constitue l’essence même du modèle qui a fait la fierté du pays depuis 1990.
Quel avenir pour les idéaux de 1990 ?
Alors que le Bénin s’apprête à marquer les 35 ans de sa transition démocratique, un débat profond mérite d’être posé : les principes de la Conférence nationale sont-ils encore en phase avec la gouvernance actuelle ? Sommes-nous toujours dans un État où le citoyen peut s’exprimer librement sans crainte ? Où l’alternance politique reste une réalité accessible à tous les courants idéologiques ?
Ces interrogations, loin d’être une simple nostalgie du passé, sont essentielles pour évaluer le chemin parcouru et redéfinir les bases d’une démocratie véritablement inclusive. Car un acquis démocratique n’est jamais définitivement acquis : il se préserve et s’entretient par une vigilance citoyenne constante.
En février 1990, le peuple béninois a choisi la démocratie. En février 2025, il doit se demander s’il en est toujours le maître.